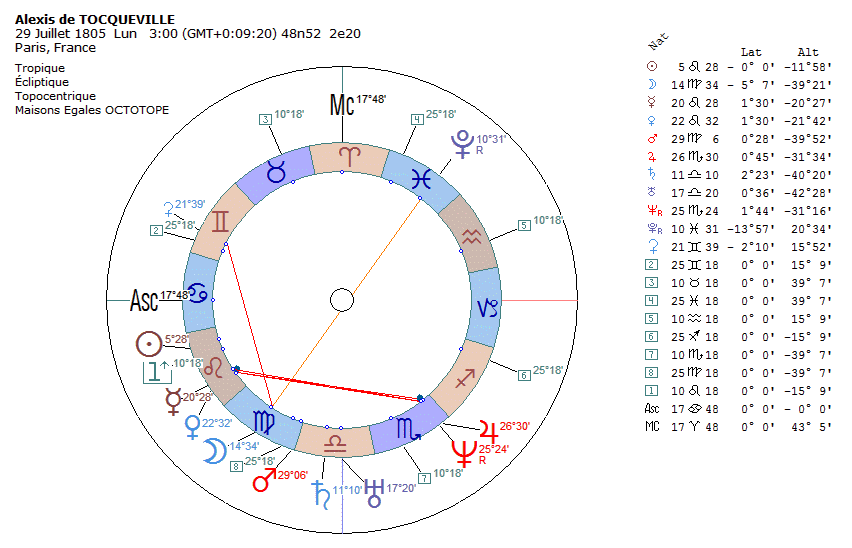
| Le Manifeste | | | Le Dominion | | | Textes et Articles | | | Historique | | | Liens | | | ACCUEIL (FR) | | | HOME (EN) |
| Alexis de Tocqueville,
le Visionnaire de la Modernité
(Avec des extraits de sa Démocratie en Amérique) par Patrice Guinard |
Au retour de son séjour aux États-Unis (1831-1832), Tocqueville entame la rédaction de sa Démocratie en Amérique. Comprenant que le régime politique et les conditions de vie en vigueur outre-Atlantique allaient se généraliser partout ailleurs, à commencer par la vieille Europe, et que la propagation du modèle démocratique américain était inéluctable, il a essayé d'en formuler les caractéristiques, et d'en imaginer l'évolution.
Tocqueville annonce l'avènement d'une société égalitaire, fondée sur l'individualisme, l'agitation, et l'isolement, d'autant plus marqués que, paradoxalement, chacun sera devenu plus semblable à autrui: "Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs." (Démocratie, II 4.6) Et aussi l'avènement d'une oppression d'un genre nouveau, qui n'est plus despotisme ou tyrannie, mais une "sorte de servitude, réglée, douce et paisible (...), un pouvoir unique, tutélaire, tout-puissant, [agissant par] un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes [qui] ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige; il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse; il ne détruit point, il empêche de naître; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger." (Démocratie, II 4.6)
Le principal danger qui guette les citoyens de la conglomération unique et mondiale - désormais le quotidien de chacun - n'est pas externe, mais interne : c'est principalement l'inconscience de la servitude, cette "servitude volontaire" dont Étienne de la Boétie avait fait l'objet de son traité politique (1548). Le serf moderne, ou post-moderne, contrairement à celui des sociétés antiques et médiévales, n'est plus conscient de sa servitude, car il se paye de mots et subit passivement le discours idéologique qu'il produit lui-même, collectivement. A la fois isolé et enferré, individualiste et noyé dans la collectivité. Le maître de jadis pouvait aimer son serviteur ; le serf d'aujourd'hui est son propre oppresseur. Car dans cette servitude généralisée, le serf ne se distingue plus du maître. Chacun tend à devenir l'oppresseur et l'oppressé de l'autre, non directement car l'autre, invisible, se manifeste dans l'ombre des règlements, des lois et des transactions. Tous se ressemblent, car les conditions d'existence et des modes de vie tendent à devenir les mêmes. Cette entreprise d'acculturation mondiale, sans précédent dans l'histoire de l'humanité - car ce qui disparaît n'est remplacé par rien - est sans visage et sans voix, bien que bruyante, menée par tous et au profit de personne.
"Modes de vie" n'est pas "niveaux de vie", et il n'existe qu'un critère qui permette de rendre compte des "modes de vie" : le taux de suicide, dont on connaît l'accroissement dans les sociétés industrielles et post-industrielles, en France, au Japon. L'égalité des conditions est une idée beaucoup plus radicale que l'inégalité des richesses, finalement sans importance (car le riche subit la même servitude collective), ou que le naïf concept marxiste des modes de production. Comment l'économique pourrait-il affranchir la conscience? Il est, au contraire, son principal vecteur d'asservissement!
Le mécène d'aujourd'hui est aveugle et soumis: il n'a ni intelligence, ni culture, ni foi, pour patronner de réelles initiatives originales, pour aider des talents à se développer. A l'inverse du mécène éclairé de la Renaissance, il ne cesse de subir le diktat culturel et la terreur idéologique. Il se tourne vers des associations, clubs et instituts de "bienfaisance" qui ne sont que les succursales des institutions. De même le footballeur, le chanteur et l'acteur: soudainement enrichis par le système et qu'on fait jaser devant les micros.
Tocqueville est un visionnaire. La réalité lui a donné raison : conditions de vies égales, dégradation des moeurs et de la convivialité. Sur le modèle américain? ou sur le russe? : Tocqueville hésite. Peu importe, car c'est la même chose. La chute du Mur de Berlin n'a pas marqué la libération des nations d'Europe orientale, mais leur entrée dans la servitude commune. Réciproquement, à la chute du Mur, ce n'est pas le soviétique qui s'est européanisé, mais plutôt l'européen qui s'est un peu plus "soviétisé", "chinisé". L'abbé Ferdinando Galiani, "le plus profond et le plus lucide des hommes de son siècle" (selon Nietzsche), écrivait déjà en 1771, dans une lettre adressée à Louise d'Épinay : "Nous ressemblerons dans cent ans beaucoup plus aux Chinois que nous ne leur ressemblons à présent. (...) Il y aura despotisme par-tout, mais despotisme sans cruauté, sans goutte de sang répandue. Un despotisme de chicane et fondé toujours sur l'interprétation des vieilles lois, sur la ruse et l'astuce du palais et de la robe, et le despotisme ne visera qu'aux finances des particuliers." Cependant, une différence sépare le russe ou le bulgare d'aujourd'hui qui ont connu la servitude à visage découvert et ont pu se forger une carapace appropriée, de l'occidental qui n'a rien connu d'autre que l'illusion de la liberté, agrémentée de la Terreur idéologique mise en place à l'époque des "Droits de l'homme". C'est ce qu'on constate de visu quand un américain et un russe se croisent dans un avion: la supériorité cynique du second.
Ce n'est pas le russe ou le chinois qui est devenu capitaliste, mais ce sont l'américain et l'européen qui sont devenus "communistes". La chute du Mur est la marque de cet événement. Ce n'est pas le prolétaire qui est devenu "bourgeois", mais l'inverse. Prolétariat signifie obligation de travailler, pour subsister, selon des modalités imposées de l'extérieur, et aliénation dans un travail inutile à ses besoins et à ses aspirations propres. Or l'idéologie, à l'inverse de l'astrologie, nie qu'il puisse exister de telles aspirations propres à chacun, qui soient indépendantes du milieu socio-culturel.
Toute activité est devenue publique, socialisée, contrôlée par l'État et par le Marché. Contrairement à ce qui est assené, nous ne sommes pas dans une logique des "Droits de l'Homme", et il n'y a pas de stade "bourgeois", comme le croit Marx. Il n'y a qu'Aristocratie ou Prolétariat: c'est ce qu'a compris Tocqueville dans son autre ouvrage, L'Ancien Régime et la Révolution (1856). Nul n'est plus en mesure d'exercer une activité conforme à ses aspirations, ni de jouir librement des fruits de cette activité, sans avoir de comptes à rendre, sans avoir à en faire profiter quiconque, sans être tributaire du racket étatique. Ainsi de sa femme, ou de ses femmes, de ses enfants, non plus réels mais publics, modélisés.
Tocqueville, en apparence optimiste, espère que la modernité choisira en fin de compte la voie de la "liberté". Il est en réalité un pessimiste: il ne croit pas que les nations et les peuples aient réellement le choix, et les dernières observations de son traité sonnent faux. Son optimisme forcé signe l'idiosyncrasie typique du Lion moderne, accentuée par la forte présence de Pluton au MC en Poissons, et de la Lune au FC en Participation Nocturne. (cf. infra: le thème de Tocqueville).
Tocqueville demeure l'un des piliers pour une réflexion sur la modernité, comme l'a montré François Furet (Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1978). Il a vu et prévu l'avènement de la société future, la nôtre, avec un ou deux siècles d'avance. Les astrologues se targuent d'une illusoire capacité à prédire ou pronostiquer le futur, alors qu'ils sont impuissants face à l'avenir proche, à seulement quelques semaines d'une échéance (cf. les récentes élections américaines: novembre-décembre 2000). Les plus rusés dressent des bilans mitigés, parsemés de formules ambiguës, qui pourront paraître valider leurs pronostics aux yeux d'un public crédule. Je l'ai déjà dit: ce n'est pas là faire de l'astrologie, mais la reconduire à coup sûr vers le jeu de dupes dans lequel elle s'est noyée il y a trois siècles.
Comment en outre, le nez collé sur ses horoscopes, l'astrologue pourrait-il acquérir une vision ample, saine et éclairée sur son temps ? L'astrologie mondiale est une affaire de grands cycles, de culture, et de réflexion politique. L'astrologue de cabinet reste muet sur l'évolution des mentalités et des idéologies, et s'escrime généralement sur l'événementiel - et il est même douteux qu'il existe aujourd'hui un "authentique événementiel" qui ne soit pas une fabrication artificielle du "Spectacle" (Guy Debord).
L'idéologie moderne stipule que la libre et bonne volonté commande les réformes utiles au sein des sociétés démocratiques. Or les gouvernements n'agissent en réalité que sous la double contrainte des pressions économico-financières, et de l'opinion publique, puisque ce sont les masses qui leur accordent et leur retirent leurs suffrages. Les politiciens, collectivement, cherchent à contenir l'opinion publique par la démagogie et par la publicité, et à faire passer les diktats du Marché pour le choix raisonnable. Tout l'effort politique consiste à convaincre les citoyens de la nécessité de cette identification. Puis, à l'heure de la compétition, chacun d'eux tente de persuader qu'il incarne le mieux ce consensus, et qu'il fait les meilleurs choix, ceux du bon sens politique : boucs et singes en effigies d'un spectacle qui se résume à l'animation d'une girouette velléitaire, orientée par la concurrence de pantins, rivaux interchangeables, soumis à l'opinion et aux pressions du Marché. Aucune époque n'a connu pareille dégénérescence de la volonté politique.
Michel Foucault a montré que le pouvoir moderne n'était ni matériel (contrainte physique), ni personnel (contrainte volontaire), ni politique, mais structurel, et caractérisé par son ubiquité, sa multi-localisation, son immanence, constitué d'une multitude de micro-pouvoirs répartis entre tous les acteurs, avec des lieux de plus grande condensation. En fait le "pouvoir moderne" n'est qu'illusion : "auto"-suggestion de l'idéologie intériorisée par chacun.
L'idéologie semble fonctionner par idées séparées ou par couples de contraires (gauche/droite, politique/justice, privé/public...), passant sous silence les présupposés du système : la "réforme" fait partie intégrante du dispositif, elle en est la continuation prévue, car il s'agit toujours d'en reconduire l'ensemble sous une forme quelque peu modifiée. Mais l'idéologie moderne est un concept beaucoup plus vaste qui dépasse son aspect politique, le plus naïf. L'idéologie, c'est la forme intériorisée de la servitude commune décrite par Tocqueville. Je propose trois critères de reconnaissance:
- L'idéologie imprègne la conscience. Elle ne fait qu'un avec la conscience. Elle n'est pas un objet extérieur de pensée aisément identifiable, ni auquel on s'oppose aisément, mais elle est cet état de penser qui influe incidemment sur les jugements émis sur ce auquel on croit s'opposer. L'idéologie est tellement prégnante qu'on y retombe encore quand on croit s'en libérer. Ainsi: éteindre le poste de radio (qui transmet le discours de circonstance déjà entendu cent fois ailleurs et par d'autres, car l'important n'est pas le locuteur, mais que le babillage consensuel soit transmis, peu importe par qui pourvu qu'il y ait quelqu'un qui puisse le transmettre) ... et mettre un disque de rap!
- L'idéologie n'est pas extérieure, chez les autres, en Chine, sous le Reich, chez les Zoulous, ou du temps des Aztèques : elle est actuelle, en acte, "chez nous", omniprésente. Ce qui se passe ailleurs n'est que curiosité: l'idéologie, c'est d'abord le discours du voisin ou de votre femme. La dénonciation de l'idéologie présupposée chez les autres n'est pas faite pour convaincre les autres, mais pour renforcer l'idéologie chez nous. Il en va de même des institutions pénitencières chez Foucault. L'idéologie produit naturellement ses réformateurs, critiques et sceptiques attitrés, ses bouffons; elle sait les reconnaître et les rémunérer en conséquence. Ainsi s'explique d'ailleurs l'effondrement soviétique: par la supériorité de l'idéologie occidentale et de ses élites intellectuelles. Le lourd appareillage de la propagande soviétique était naïf: il suffisait de flatter l'amour-propre, de laisser chantonner les sirènes de la liberté, de la volonté, de la responsabilité, du partage, de faire croire à chacun qu'il est l'auteur, l'acteur et surtout l'entrepreneur de son existence.
- L'idéologie ne tient pas en quelques idées, valeurs ou lignes directrices, ni même en un réseau d'idées. Elle est une organisation structurelle sous-jacente aux idées, une disposition de l'esprit. Elle est le théâtre d'implosion de toutes les idées dans l'esprit. Aussi ne combat-on pas l'idéologie par le discours, l'argumentation, la raison, l'intelligence, car, par définition, l'idéologie a déjà truqué tous les discours, toutes les argumentations. Elle a biaisé la raison et miné l'intelligence. On ne peut la combattre que par le silence.
Le terme idéologie a été forgé par le philosophe Destutt de Tracy pour désigner la connaissance des idées ou faits de conscience. Marx s'en empare pour qualifier les penseurs inconscients des réalités économiques et matérielles sous-jacentes à leur raisonnement. Depuis, il est couramment utilisé pour disqualifier sans procès les idées qui ne se conforment pas aux normes de la pensée, de la raison ou du consensus. J'appelle, quant à moi, idéologie, non pas le système de représentations mentales qui caractérisent la mentalité d'une "classe dominante" (Marx), mais l'ensemble des réflexes culturels de la mentalité dominante, toutes "classes" confondues, inconsciemment vécus par le plus grand nombre, et en tant qu'ils évacuent, neutralisent et excluent les représentations mentales concurrentes qui caractérisent la différence. L'idéologie s'enracine dans les esprits à travers l'ignorance (signes printaniers), la peur (signes estivaux), la paresse (signes automnaux), et la lâcheté (signes hivernaux).
L'astrologie m'intéresse depuis 20 ans. Elle est la seule alternative à l'idéologie, car elle fonctionne, elle-aussi, comme "une" idéologie: prégnance, structuration de la conscience, ubiquité, insaisissabilité.
Le magazine new-yorkais Considerations a récemment publié (15.1, 2000, p.89) le thème de naissance de Tocqueville. Mme Nicole Girard a retrouvé l'acte de naissance d'Alexis de Tocqueville aux Archives de la Seine: Charles Alexis Clérel de Tocqueville est né le 29 juillet 1805, à Paris, à 3 heures du matin: "Tocqueville's birth (family name = Clérel) is registered as No. 174 for 29 Juillet 1805 (11 Thermidor an XIII) at the Préfecture du département de la Seine, ville de Paris, premier arrondissement. Birth occurred at Rue de la Ville l'Évêque, numéro 987, division du Roule." (courrier personnel de l'éditeur, Ken Gillman, daté du 28 mars 2000). Ce petit texte a été rédigé pour honorer cette précieuse découverte. Un horoscope tel que celui-ci en vaut largement cent autres d'un intérêt limité. Mieux vaut approfondir et comprendre un seul thème d'un homme de valeur, que dresser hâtivement les thèmes de dizaines de pantins.
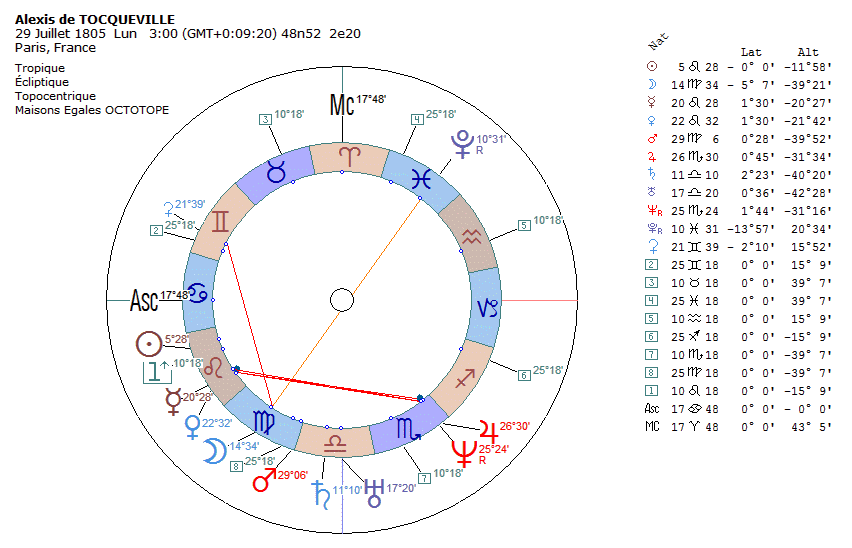
Pluton au MC, et seule planète au-dessus de l'horizon, domine le thème de Tocqueville. En face: la Lune. Les hommes, individualités distinctes et sur-différenciées (Pluton) mais formant un seul corps (Lune), sont fragilisés par la passivité de la Vierge et par l'instabilité de la Maison VII (Participation Nocturne), la maison plutonienne. Regroupés dans une collectivité amorphe (Lune) et désunie (Pluton), sans convivialité, ils restent soumis à un destin qu'ils sont incapables de maîtriser et asservis à des inconnues qui les dépassent totalement (Maison VII, le Mystère). Cette configuration est la marque d'une servitude (Lune), d'autant plus implacable et étroite (axe Poissons / Vierge des restrictions et des limitations) qu'elle demeure inconsciente (maison VII). L'autre pôle de ce thème, étranger au premier et sans relation avec lui, est marqué par le Soleil en Lion et Individuation Nocturne. Le pouvoir tutélaire (Soleil), coupé du "peuple", poursuit ses desseins (maison VIII) sans méchanceté, mais sans concertation (Lion). Ce pôle léonin marque aussi le regard que l'historien porte sur le phénomène appréhendé, lequel veut croire, en dépit de son constat, que les hommes trouveront, finalement, le moyen de surmonter les épreuves qui les accablent.
Alexis de Tocqueville: De la démocratie en AmériqueQuelques extraits de La Démocratie de Tocqueville choisis par moi-même. Le lecteur pourra trouver les textes de La Démocratie et de L'Ancien régime et la Révolution (1856), à cette excellente adresse: Les classiques des sciences sociales
Introduction
Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux États-Unis, ont attiré mon attention, aucun n'a plus vivement frappé mes regards que l'égalité des conditions. Je découvris sans peine l'influence prodigieuse qu'exerce ce premier fait sur la marche de la société; il donne à l'esprit public une certaine direction, un certain tour aux lois; aux gouvernants des maximes nouvelles, et des habitudes particulières aux gouvernés.
Bientôt je reconnus que ce même fait étend son influence fort au-delà des moeurs politiques et des lois, et qu'il n'obtient pas moins d'empire sur la société civile que sur le gouvernement: il crée des opinions, fait naître des sentiments, suggère des usages et modifie tout ce qu'il ne produit pas.
Ainsi donc, à mesure que j'étudiais la société américaine, je voyais de plus en plus, dans l'égalité des conditions, le fait générateur dont chaque fait particulier semblait descendre, et je le retrouvais sans cesse devant moi comme un point central où toutes mes observations venaient aboutir.
(...)
A mesure cependant qu'il se découvre des routes nouvelles pour parvenir au pouvoir, on voit baisser la valeur de la naissance. Au XIe siècle, la noblesse était d'un prix inestimable; on l'achète au XIIIe ; le premier anoblissement a lieu en 1270, et l'égalité s'introduit enfin dans le gouvernement par l'aristocratie elle-même.
Durant les sept cents ans qui viennent de s'écouler, il est arrivé quelquefois que, pour lutter contre l'autorité royale ou pour enlever le pouvoir à leurs rivaux, les nobles ont donné une puissance politique au peuple.
Plus souvent encore, on a vu les rois faire participer au gouvernement les classes inférieures de l'État, afin d'abaisser l'aristocratie.
En France, les rois se sont montrés les plus actifs et les plus constants des niveleurs. Quand ils ont été ambitieux et forts, ils ont travaillé à élever le peuple au niveau des nobles; et quand ils ont été modérés et faibles, ils ont permis que le peuple se plaçât au-dessus d'eux-mêmes. Les uns ont aidé la démocratie par leurs talents, les autres par leurs vices. Louis XI et Louis XIV ont pris soin de tout égaliser au-dessous du trône, et Louis XV est enfin descendu lui-même avec sa cour dans la poussière.
(...)
Partout on a vu les divers incidents de la vie des peuples tourner au profit de la démocratie; tous les hommes l'ont aidée de leurs efforts: ceux qui avaient en vue de concourir à ses succès et ceux qui ne songeaient point à la servir; ceux qui ont combattu pour elle, et ceux mêmes qui se sont déclarés ses ennemis; tous ont été poussés pêle-mêle dans la même voie, et tous ont travaillé en commun, les uns malgré eux, les autres à leur insu, aveugles instruments dans les mains de Dieu.
Le développement graduel de l'égalité des conditions est donc un fait providentiel, il en a les principaux caractères: il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine; tous les événements, comme tous les hommes, servent à son développement.
(...)
Placés à une distance immense du peuple, les nobles prenaient cependant au sort du peuple cette espèce d'intérêt bienveillant et tranquille que le pasteur accorde à son troupeau; et, sans voir dans le pauvre leur égal, ils veillaient sur sa destinée, comme sur un dépôt remis par la Providence entre leurs mains.
N'ayant point conçu l'idée d'un autre état social que le sien, n'imaginant pas qu'il pût jamais s'égaler à ses chefs, le peuple recevait leurs bienfaits et ne discutait point leurs droits. Il les aimait lorsqu'ils étaient cléments et justes, et se soumettait sans peine et sans bassesse à leurs rigueurs, comme à des maux inévitables que lui envoyait le bras de Dieu. L'usage et les moeurs avaient d'ailleurs établi des bornes à la tyrannie et fondé une sorte de droit au milieu même de la force.
Le noble n'ayant point la pensée qu'on voulût lui arracher des privilèges qu'il croyait légitimes; le serf regardant son infériorité comme un effet de l'ordre immuable de la nature, on conçoit qu'il put s'établir une sorte de bienveillance réciproque entre ces deux classes si différemment partagées du sort. On voyait alors dans la société, de l'inégalité, des misères, mais les âmes n'y étaient pas dégradées.
Ce n'est point l'usage du pouvoir ou l'habitude de l'obéissance qui déprave les hommes, c'est l'usage d'une puissance qu'ils considèrent comme illégitime, et l'obéissance à un pouvoir qu'ils regardent comme usurpé et comme oppresseur.
(...)
Du Gouvernement de la Démocratie en Amérique (1.2.5)
(...)
Bien des gens, en Europe, croient sans le dire, ou disent sans le croire, qu'un des grands avantages du vote universel est d'appeler à la direction des affaires des hommes dignes de la confiance publique. Le peuple ne saurait gouverner lui-même, dit-on, mais il veut toujours sincèrement le bien de l'État, et son instinct ne manque guère de lui désigner ceux qu'un même désir anime et qui sont les plus capables de tenir en main le pouvoir.
Pour moi, je dois le dire, ce que j'ai vu en Amérique ne m'autorise point à penser qu'il en soit ainsi. A mon arrivée aux États-Unis, je fus frappé de surprise en découvrant à quel point le mérite était commun parmi les gouvernés, et combien il l'était peu chez les gouvernants. C'est un fait constant que, de nos jours, aux États-Unis, les hommes les plus remarquables sont rarement appelés aux fonctions publiques, et l'on est obligé de reconnaître qu'il en a été ainsi a mesure que la démocratie a dépassé toutes ses anciennes limites. Il est évident que la race des hommes d'État américains s'est singulièrement rapetissée depuis un demi-siècle.
(...)
Du reste, ce n'est pas toujours la capacité qui manque à la démocratie pour choisir les hommes de mérite, mais le désir et le goût.
Il ne faut pas se dissimuler que les institutions démocratiques développent à un très haut degré le sentiment de l'envie dans le coeur humain. Ce n'est point tant parce qu'elles offrent à chacun des moyens de s'égaler aux autres, mais parce que ces moyens défaillent sans cesse à ceux qui les emploient. Les institutions démocratiques réveillent et flattent la passion de l'égalité sans pouvoir jamais la satisfaire entièrement. Cette égalité complète s'échappe tous les jours des mains du peuple au moment où il croit la saisir, et fuit, comme dit Pascal, d'une fuite éternelle; le peuple s'échauffe à la recherche de ce bien d'autant plus précieux qu'il est assez près pour être connu, assez loin pour n'être point goûté. La chance de réussir l'émeut, l'incertitude du succès l'irrite; il s'agite, il se lasse, il s'aigrit. Tout ce qui le dépasse par quelque endroit lui paraît alors un obstacle à ses désirs, et il n'y a pas de supériorité si légitime dont la vue ne fatigue ses yeux.
(...)
Quelques considérations sur l'état actuel et l'avenir probable des trois races qui habitent le territoire des États-Unis (1.2.10)
(...)
Parmi ces hommes si divers, le premier qui attire les regards, le premier en lumière, en puissance, en bonheur, c'est l'homme blanc, l'Européen, l'homme par excellence; au-dessous de lui paraissent le Nègre et l'Indien.
Ces deux races infortunées n'ont de commun ni la naissance, ni la figure, ni le langage, ni les moeurs; leurs malheurs seuls se ressemblent. Toutes deux occupent une position également inférieure dans le pays qu'elles habitent; toutes deux éprouvent les effets de la tyrannie; et si leurs misères sont différentes, elles peuvent en accuser les mêmes auteurs.
Ne dirait-on pas, a voir ce qui se passe dans le monde, que l'Européen est aux hommes des autres races ce que l'homme lui-même est aux animaux ? Il les fait servir à son usage, et quand il ne peut les plier, il les détruit.
L'oppression a enlevé du même coup, aux descendants des Africains , presque tous les privilèges de l'humanité! Le Nègre des États-Unis a perdu jusqu'au souvenir de son pays; il n'entend plus la langue qu'ont parlée ses pères; il a abjuré leur religion et oublié leurs moeurs. En cessant ainsi d'appartenir à l'Afrique, il n'a pourtant acquis aucun droit aux biens de l'Europe; mais il s'est arrêté entre les deux sociétés; il est resté isolé entre les deux peuples; vendu par l'un et répudié par l'autre; ne trouvant dans l'univers entier que le foyer de son maître pour lui offrir l'image incomplète de la patrie.
(...)
Conclusion
(...)
Il arrivera donc un temps où l'on pourra voir dans l'Amérique du Nord cent cinquante millions d'hommes égaux entre eux, qui tous appartiendront à la même famille, qui auront le même point de départ, la même civilisation, la même langue, la même religion, les mêmes habitudes, les mêmes moeurs, et à travers lesquels la pensée circulera sous la même forme et se peindra des mêmes couleurs. Tout le reste est douteux, mais ceci est certain. Or, voici un fait entièrement nouveau dans le monde, et dont l'imagination elle-même ne saurait saisir la portée.
Il y a aujourd'hui sur la terre deux grands peuples qui, partis de points différents, semblent s'avancer vers le même but: ce sont les Russes et les Anglo-Américains.
Tous deux ont grandi dans l'obscurité; et tandis que les regards des hommes étaient occupés ailleurs, ils se sont placés tout à coup au premier rang des nations, et le monde a appris presque en même temps leur naissance et leur grandeur.
Tous les autres peuples paraissent avoir atteint à peu près les limites qu'a tracées la nature, et n'avoir plus qu'à conserver; mais eux sont en croissance : tous les autres sont arrêtés ou n'avancent qu'avec mille efforts; eux seuls marchent d'un pas aisé et rapide dans une carrière dont l’oeil ne saurait encore apercevoir la borne.
L'Américain lutte contre les obstacles que lui oppose la nature; le Russe est aux prises avec les hommes. L'un combat le désert et la barbarie, l'autre la civilisation revêtue de toutes ses armes: aussi les conquêtes de l'Américain se font-elles avec le soc du laboureur, celles du Russe avec l'épée du soldat.
Pour atteindre son but, le premier s'en repose sur l'intérêt personnel, et laisse agir, sans les diriger, la force et la raison des individus.
Le second concentre en quelque sorte dans un homme toute la puissance de la société.
L'un a pour principal moyen d'action la liberté; l'autre, la servitude.
Leur point de départ est différent, leurs voies sont diverses; néanmoins, chacun d'eux semble appelé par un dessein secret de la Providence à tenir un jour dans ses mains les destinées de la moitié du monde.
De l'industrie littéraire (2.1.14)
La démocratie ne fait pas seulement pénétrer le goût des lettres dans les classes industrielles, elle introduit l'esprit industriel au sein de la littérature.
Dans les aristocraties, les lecteurs sont difficiles et peu nombreux; dans les démocraties, il est moins malaisé de leur plaire, et leur nombre est prodigieux. Il résulte de là que, chez les peuples aristocratiques, on ne doit espérer de réussir qu'avec d'immenses efforts, et que ces efforts, qui peuvent donner beaucoup de gloire, ne sauraient jamais procurer beaucoup d'argent; tandis que, chez les nations démocratiques, un écrivain peut se flatter d'obtenir à bon marché une médiocre renommée et une grande fortune. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'on l'admire, il suffit qu'on le goûte.
La foule toujours croissante des lecteurs et le besoin continuel qu'ils ont du nouveau assurent le débit d'un livre qu'ils n'estiment guère.
Dans les temps de démocratie, le public en agit souvent avec les auteurs comme le font d'ordinaire les rois avec leurs courtisans; il les enrichit et les méprise. Que faut-il de plus aux âmes vénales qui naissent dans les cours, ou qui sont dignes d'y vivre?
Les littératures démocratiques fourmillent toujours de ces auteurs qui n'aperçoivent dans les lettres qu'une industrie, et, pour quelques grands écrivains qu'on y voit, on y compte par milliers des vendeurs d'idées.
De l'individualisme dans les pays démocratiques (2.2.2)
J'ai fait voir comment, dans les siècles d'égalité, chaque homme cherchait en lui-même ses croyances; je veux montrer comment, dans les mêmes siècles, il tourne tous ses sentiments vers lui seul.
L'individualisme est une expression récente qu'une idée nouvelle a fait naître. Nos pères ne connaissaient que l'égoïsme.
L'égoïsme est un amour passionné et exagéré de soi-même, qui porte l'homme à ne rien rapporter qu'à lui seul et à se préférer à tout.
L'individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis; de telle sorte que, après s'être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même.
L'égoïsme naît d'un instinct aveugle; l'individualisme procède d'un jugement erroné plutôt que d'un sentiment dépravé. Il prend sa source dans les défauts de l'esprit autant que dans les vices du coeur.
L'égoïsme dessèche le germe de toutes les vertus, l'individualisme ne tarit d'abord que la source des vertus publiques; mais, à la longue, il attaque et détruit toutes les autres et va enfin s'absorber dans l'égoïsme.
L'égoïsme est un vice aussi ancien que le monde. Il n'appartient guère plus à une forme de société qu'à une autre.
L'individualisme est d'origine démocratique, et il menace de se développer à mesure que les conditions s'égalisent.
Chez les peuples aristocratiques, les familles restent pendant des siècles dans le même état, et souvent dans le même lieu. Cela rend, pour ainsi dire, toutes les générations contemporaines. Un homme connaît presque toujours ses aïeux et les respecte; il croit déjà apercevoir ses arrière-petits-fils, et il les aime. Il se fait volontiers des devoirs envers les uns et les autres, et il lui arrive fréquemment de sacrifier ses jouissances personnelles à ces êtres qui ne sont plus ou qui ne sont pas encore.
Les institutions aristocratiques ont, de plus, pour effet de lier étroitement chaque homme à plusieurs de ses concitoyens.
Les classes étant fort distinctes et immobiles dans le sein d'un peuple aristocratique, chacune d'elles devient pour celui qui en fait partie une sorte de petite patrie, plus visible et plus chère que la grande.
Comme, dans les sociétés aristocratiques, tous les citoyens sont placés à poste fixe, les uns au-dessus des autres, il en résulte encore que chacun d'entre eux aperçoit toujours plus haut que lui un homme dont la protection lui est nécessaire, et plus bas il en découvre un autre dont il peut réclamer le concours.
Les hommes qui vivent dans les siècles aristocratiques sont donc presque toujours liés d'une manière étroite à quelque chose qui est placé en dehors d'eux, et ils sont souvent disposés à s'oublier eux-mêmes. Il est vrai que, dans ces mêmes siècles, la notion générale du semblable est obscure, et qu'on ne songe guère à s'y dévouer pour la cause de l'humanité; mais on se sacrifie souvent à certains hommes.
Dans les siècles démocratiques, au contraire, où les devoirs de chaque individu envers l'espèce sont bien plus clairs, le dévouement envers un homme devient plus rare : le lien des affections humaines s'étend et se desserre.
Chez les peuples démocratiques, de nouvelles familles sortent sans cesse du néant, d'autres y retombent sans cesse, et toutes celles qui demeurent changent de face; la trame des temps se rompt à tout moment, et le vestige des générations s'efface. On oublie aisément ceux qui vous ont précédé, et l'on n'a aucune idée de ceux qui vous suivront. Les plus proches seuls intéressent.
Chaque classe venant à se rapprocher des autres et à s'y mêler, ses membres deviennent indifférents et comme étrangers entre eux. L'aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan au roi; la démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part.
A mesure que les conditions s'égalisent, il se rencontre un plus grand nombre d'individus qui, n'étant plus assez riches ni assez puissants pour exercer une grande influence sur le sort de leurs semblables, ont acquis cependant ou ont conservé assez de lumières et de biens pour pouvoir se suffire à eux-mêmes. Ceux-là ne doivent rien à personne, ils n'attendent pour ainsi dire rien de personne; ils s'habituent à se considérer toujours isolément, et ils se figurent volontiers que leur destinée tout entière est entre leurs mains.
Ainsi, non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses descendants et le sépare de ses contemporains; elle le ramène sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre coeur.
Comment l'aristocratie pourrait sortie de l'industrie (2.2.20)
(...)
Quand un artisan se livre sans cesse et uniquement à la fabrication d'un seul objet, il finit par s'acquitter de ce travail avec une dextérité singulière. Mais il perd, en même temps, la faculté générale d'appliquer son esprit à la direction du travail. Il devient chaque jour plus habile et moins industrieux, et l'on peut dire qu'en lui l'homme se dégrade à mesure que l'ouvrier se perfectionne.
Que doit-on attendre d'un homme qui a employé vingt ans de sa vie à faire des têtes d'épingles? et à quoi peut désormais s'appliquer chez lui cette puissante intelligence humaine, qui a souvent remué le monde, sinon à rechercher le meilleur moyen de faire des tètes d'épingles !
Lorsqu'un ouvrier a consumé de cette manière une portion considérable de son existence, sa pensée s'est arrêtée pour jamais près de l'objet journalier de ses labeurs; son corps a contracté certaines habitudes fixes dont il ne lui est plus permis de se départir. Et, un mot, il n'appartient plus à lui-même, mais à la profession qu'il a choisie. C'est en vain que les lois et les moeurs ont pris soin de briser autour de cet homme toutes les barrières et de lui ouvrir de tous côtés mille chemins différents vers la fortune; une théorie industrielle plus puissante que les moeurs et les lois l'a attaché à un métier, et souvent à un lieu qu'il ne peut quitter. Elle lui a assigné dans la société une certaine place dont il ne peut sortir. Au milieu du mouvement universel, elle l'a rendu immobile.
A mesure que le principe de la division du travail reçoit une application plus complète, l'ouvrier devient plus faible, plus borné et plus dépendant. L'art fait des progrès, l'artisan rétrograde. D'un autre côté, à mesure qu'il se découvre plus manifestement que les produits d'une industrie sont d'autant plus parfaits et d'autant moins chers que la manufacture est plus vaste et le capital plus grand, des hommes très riches et très éclairés se présentent pour exploiter des industries qui, jusque-là, avaient été livrées à des artisans ignorants ou malaisés. La grandeur des efforts nécessaires et l'immensité des résultats à obtenir les attirent.
Ainsi donc, dans le même temps que la science industrielle abaisse sans cesse la classe des ouvriers, elle élève celle des maîtres.
Tandis que l'ouvrier ramène de plus en plus son intelligence à l'étude d'un seul détail, le maître promène chaque jour ses regards sur un plus vaste ensemble, et son esprit s'étend en proportion que celui de l'autre se resserre. Bientôt il ne faudra plus au second que la force physique sans l'intelligence; le premier a besoin de la science, et presque du génie pour réussir. L'un ressemble de plus en plus à l'administrateur d'un vaste empire, et l'autre à une brute.
Le maître et l'ouvrier n'ont donc ici rien de semblable, et ils diffèrent chaque jour davantage. Ils ne se tiennent que comme les deux anneaux extrêmes d'une longue chaîne. Chacun occupe une place qui est faite pour lui, et dont il ne sort point. L'un est dans une dépendance continuelle, étroite et nécessaire de l'autre, et semble né pour obéir, comme celui-ci pour commander.
Qu'est-ce ceci, sinon de l'aristocratie ?
Les conditions venant à s'égaliser de plus en plus dans le corps de la nation, le besoin des objets manufacturés s'y généralise et s'y accroît, et le bon marché qui met ces objets à la portée des fortunes médiocres, devient un plus grand élément de succès.
Il se trouve donc chaque jour que des hommes plus opulents et plus éclairés consacrent à l'industrie leurs richesses et leurs sciences et cherchent, en ouvrant de grands ateliers et en divisant strictement le travail, à satisfaire les nouveaux désirs qui se manifestent de toutes parts.
Ainsi, à mesure que la masse de la nation tourne à la démocratie, la classe particulière qui s'occupe d'industrie devient plus aristocratique. Les hommes se montrent de plus en plus semblables dans l'une et de plus en plus différents dans l'autre, et l'inégalité augmente dans la petite société en proportion qu'elle décroît dans la grande.
C'est ainsi que, lorsqu'on remonte à la source, il semble qu'on voie l'aristocratie sortir par un effort naturel du sein même de la démocratie.
Mais cette aristocratie-là ne ressemble point à celles qui l'ont précédée.
On remarquera d'abord que, ne s'appliquant qu'à l'industrie et à quelques-unes des professions industrielles seulement, elle est une exception, un monstre, dans l'ensemble de l'état social.
Les petites sociétés aristocratiques que forment certaines industries au milieu de l'immense démocratie de nos jours renferment, comme les grandes sociétés aristocratiques des anciens temps, quelques hommes très opulents et une multitude très misérable.
Ces pauvres ont peu de moyens de sortir de leur condition et de devenir riches, mais les riches deviennent sans cesse des pauvres, ou quittent le négoce après avoir réalisé leurs profits. Ainsi, les éléments qui forment la classe des pauvres sont à peu près fixes; mais les éléments qui composent la classe des riches ne le sont pas. A vrai dire, quoiqu'il y ait des riches, la classe des riches n'existe point; car ces riches n'ont pas d'esprit ni d'objets communs, de traditions ni d'espérances communes. Il y a donc des membres, mais point de corps.
Non seulement les riches ne sont pas unis solidement entre eux, mais on peut dire qu'il n'y a pas de lien véritable entre le pauvre et le riche.
Ils ne sont pas fixés à perpétuité l'un près de l'autre; à chaque instant l'intérêt les rapproche et les sépare. L'ouvrier dépend en général des maîtres, mais non de tel maître. Ces deux hommes se voient à la fabrique et ne se connaissent pas ailleurs, et tandis qu'ils se touchent par un point, ils restent fort éloignés par tous les autres. Le manufacturier ne demande à l'ouvrier que son travail, et l'ouvrier n'attend de lui que le salaire. L'un ne s'engage point à protéger, ni l'autre à défendre, et ils ne sont liés d'une manière permanente, ni par l'habitude, ni par le devoir.
L'aristocratie que fonde le négoce ne se fixe presque jamais au milieu de la population industrielle qu'elle dirige; son but n'est point de gouverner celle-ci, mais de s'en servir.
Une aristocratie ainsi constituée ne saurait avoir une grande prise sur ceux qu'elle emploie; et, parvint-elle à les saisir un moment, bientôt ils lui échappent. Elle ne sait pas vouloir et ne peut agir.
L'aristocratie territoriale des siècles passés était obligée par la loi, ou se croyait obligée par les moeurs, de venir au secours de ses serviteurs et de soulager leurs misères. Mais l'aristocratie manufacturière de nos jours, après avoir appauvri et abruti les hommes dont elle se sert, les livre en temps de crise à la charité publique pour les nourrir. Ceci résulte naturellement de ce qui précède. Entre l'ouvrier et le maître, les rapports sont fréquents, mais il n'y a pas d'association véritable.
Je pense qu'à tout prendre, l'aristocratie manufacturière que nous voyons s'élever sous nos yeux est une des plus dures qui aient paru sur la terre; mais elle est en même temps une des plus restreintes et des moins dangereuses.
Toutefois, c’est de ce côté que les amis de la démocratie doivent sans cesse tourner avec inquiétude leurs regards; car, si jamais l'inégalité permanente des conditions et l'aristocratie pénètrent de nouveau dans le monde, on peut prédire qu'elles y entreront par cette porte.
Pourquoi les grandes révolutions deviendront rares (2.3.21)
(...)
Il s'élève, il est vrai, de temps à autre, dans les sociétés démocratiques, des citoyens entreprenants et ambitieux, dont les immenses désirs ne peuvent se satisfaire en suivant la route commune. Ceux-ci aiment les révolutions et les appellent; mais ils ont grand-peine à les faire naître, si des événements extraordinaires ne viennent à leur aide.
On ne lutte point avec avantage contre l'esprit de son siècle et de son pays; et un homme, quelque puissant qu'on le suppose, fait difficilement partager à ses contemporains des sentiments et des idées que l'ensemble de leurs désirs et de leurs sentiments repousse. Il ne faut donc pas croire que, quand une fois l'égalité des conditions, devenue un fait ancien et incontesté, a imprimé aux moeurs son caractère, les hommes se laissent aisément précipiter dans les hasards à la suite d'un chef imprudent ou d'un hardi novateur.
Ce n'est pas qu'ils lui résistent d'une manière ouverte, à l'aide de combinaisons savantes, ou même par un dessein prémédité de résister. Ils ne le combattent point avec énergie, ils lui applaudissent même quelquefois, mais ils ne le suivent point. A sa fougue, ils opposent en secret leur inertie; à ses instincts révolutionnaires, leurs intérêts conservateurs, leurs goûts casaniers à ses passions aventureuses; leur bon sens aux écarts de son génie; à sa poésie, leur prose. Il les soulève un moment avec mille efforts, et bientôt ils lui échappent, et, comme entraînés par leur propre poids, ils retombent. Il s'épuise à vouloir animer cette foule indifférente et distraite, et il se voit enfin réduit à l'impuissance, non qu'il soit vaincu, mais parce qu'il est seul.
(...)
J'entends dire qu'il est dans la nature et dans les habitudes des démocraties de changer à tout moment de sentiments et de pensées. Cela peut être vrai de petites nations démocratiques, comme celles de l'Antiquité, qu'on réunissait tout entières sur une place publique et qu'on agitait ensuite au gré d'un orateur. Je n'ai rien vu de semblable dans le sein du grand peuple démocratique qui occupe les rivages opposés de notre Océan. Ce qui m'a frappé aux États-Unis, c'est la peine qu'on éprouve à désabuser la majorité d'une idée qu'elle a conçue et de la détacher d'un homme qu'elle adopte. Les écrits ni les discours ne sauraient guère y réussir; l'expérience seule en vient à bout; quelquefois encore faut-il qu'elle se répète.
Cela étonne au premier abord; un examen plus attentif l'explique.
Je ne crois pas qu'il soit aussi facile qu'on l'imagine de déraciner les préjugés d'un peuple démocratique; de changer ses croyances; de substituer de nouveaux principes religieux, philosophiques, politiques et moraux, à ceux qui s'y sont une fois établis; en un mot, d'y faire de grandes et fréquentes révolutions dans les intelligences. Ce n'est pas que l'esprit humain y soit oisif; il s'agite sans cesse; mais il s'exerce plutôt à varier à l'infini les conséquences des principes connus, et à en découvrir de nouvelles, qu'à chercher de nouveaux principes. Il tourne avec agilité sur lui-même plutôt qu'il ne s'élance en avant par un effort rapide et direct; il étend peu à peu sa sphère par de petits mouvements continus et précipités; il ne la déplace point tout à coup.
Des hommes égaux en droits, en éducation, en fortune, et, pour tout dire en un mot, de condition pareille, ont nécessairement des besoins, des habitudes et des goûts peu dissemblables. Comme ils aperçoivent les objets sous le même aspect, leur esprit incline naturellement vers des idées analogues, et quoique chacun d'eux puisse s'écarter de ses contemporains et se faire des croyances à lui, ils finissent par se retrouver tous, sans le savoir et sans le vouloir, dans un certain nombre d'opinions communes.
Plus je considère attentivement les effets de l'égalité sur l'intelligence, plus je me persuade que l'anarchie intellectuelle dont nous sommes témoins n'est pas, ainsi que plusieurs le supposent, l'état naturel des peuples démocratiques. Je crois qu'il faut plutôt la considérer comme un accident particulier à leur jeunesse, et qu'elle ne se montre qu'à cette époque de passage où les hommes ont déjà brisé les antiques liens qui les attachaient les uns aux autres, et diffèrent encore prodigieusement par l'origine, l'éducation et les moeurs; de telle sorte que, ayant conservé des idées, des instincts et des goûts fort divers, rien ne les empêche plus de les produire. Les principales opinions des hommes deviennent semblables à mesure que les conditions se ressemblent. Tel me paraît être le fait général et permanent; le reste est fortuit et passager.
Je crois qu'il arrivera rarement que, dans le sein d'une société démocratique, un homme vienne à concevoir, d'un seul coup, un système d'idées fort éloignées de celui qu'ont adopté ses contemporains; et, si un pareil novateur se présentait, j'imagine qu'il aurait d'abord grand-peine à se faire écouter, et plus encore à se faire croire.
Lorsque les conditions sont presque pareilles, un homme ne se laisse pas aisément persuader par un autre. Comme tous se voient de très près, qu'ils ont appris ensemble les mêmes choses et mènent la même vie, ils ne sont pas naturellement disposés à prendre l'un d'entre eux pour guide et à le suivre aveuglément: on ne croit guère sur parole son semblable ou son égal.
Ce n'est pas seulement la confiance dans les lumières de certains individus qui s'affaiblit chez les nations démocratiques, ainsi que je l'ai dit ailleurs, l'idée générale de la supériorité intellectuelle qu'un homme quelconque peut acquérir sur tous les autres ne tarde pas à s'obscurcir.
A mesure que les hommes se ressemblent davantage, le dogme de l'égalité des intelligences s'insinue peu à peu dans leurs croyances, et il devient plus difficile à un novateur, quel qu'il soit, d'acquérir et d'exercer un grand pouvoir sur l'esprit d'un peuple. Dans de pareilles sociétés, les soudaines révolutions intellectuelles sont donc rares; car, si l'on jette les yeux sur l'histoire du monde, l'on voit que c’est bien moins la force d'un raisonnement que l'autorité d'un nom qui a produit les grandes et rapides mutations des opinions humaines.
(...)
On croit que les sociétés nouvelles vont chaque jour changer de face, et, moi, j'ai peur qu'elles ne finissent par être trop invariablement fixées dans les mêmes institutions, les mêmes préjugés, les mêmes moeurs; de telle sorte que le genre humain s'arrête et se borne; que l'esprit se plie et se replie éternellement sur lui-même sans produire d'idées nouvelles; que l'homme s'épuise en petits mouvements solitaires et stériles, et que, tout en se remuant sans cesse, l'humanité n'avance plus.
Que les idées des peuples démocratiques en matière de gouvernement sont naturellement favorables à la concentration des pouvoirs (2.4.2)
(...)
A mesure que les conditions s'égalisent chez un peuple, les individus paraissent plus petits et la société semble plus grande, ou plutôt chaque citoyen, devenu semblable à tous les autres, se perd dans la foule, et l'on n'aperçoit plus que la vaste et magnifique image du peuple lui-même.
Cela donne naturellement aux hommes des temps démocratiques une opinion très haute des privilèges de la société et une idée fort humble des droits de l'individu. Ils admettent aisément que l'intérêt de l'un est tout et que celui de l'autre n'est rien. Ils accordent assez volontiers que le pouvoir qui représente la société possède beaucoup plus de lumières et de sagesse qu'aucun des hommes qui le composent, et que son devoir, aussi bien que son droit, est de prendre chaque citoyen par la main et de le conduire.
Si l'on veut bien examiner de près nos contemporains, et percer jusqu'à la racine de leurs opinions politiques, on y retrouvera quelques-unes des idées que je viens de reproduire, et l'on s'étonnera peut-être de rencontrer tant d'accord parmi des gens qui se font si souvent la guerre.
Les Américains croient que, dans chaque État, le pouvoir social doit émaner directement du peuple ; mais une fois que ce pouvoir est constitué, ils ne lui imaginent, pour ainsi dire, point de limites; ils reconnaissent volontiers qu'il a le droit de tout faire.
Quant à des privilèges particuliers accordés à des villes, à des familles ou à des individus, ils en ont perdu jusqu'à l'idée. Leur esprit n'a jamais prévu qu'on pût ne pas appliquer uniformément la même loi à toutes les parties du même État et à tous les hommes qui l'habitent.
Ces mêmes opinions se répandent de plus en plus en Europe; elles s'introduisent dans le sein même des nations qui repoussent le plus violemment le dogme de la souveraineté du peuple. Celles-ci donnent au pouvoir une autre origine que les Américains; mais elles envisagent le pouvoir sous les mêmes traits. Chez toutes, la notion de puissance intermédiaire s'obscurcît et s'efface. L'idée d'un droit inhérent à certains individus disparaît rapidement de l'esprit des hommes; l'idée du droit tout-puissant et pour ainsi dire unique de la société vient remplir sa place. Ces idées s'enracinent et croissent à mesure que les conditions deviennent plus égales et les hommes plus semblables; l'égalité les fait naître et elles hâtent à leur tour les progrès de l'égalité.
(...)
Que les sentiments des peuples démocratiques sont d'accord avec leurs idées pour les porter à concentrer le pouvoir (2.4.3)
(...)
Comme, dans les siècles d'égalité, nul n'est obligé de prêter sa force à son semblable, et nul n'a droit d'attendre de son semblable un grand appui, chacun est tout à la fois indépendant et faible. Ces deux états, qu'il ne faut pas envisager séparément ni confondre, donnent au citoyen des démocraties des instincts fort contraires. Son indépendance le remplit de confiance et d'orgueil au sein de ses égaux, et sa débilité lui fait sentir, de temps en temps, le besoin d'un secours étranger qu'il ne peut attendre d'aucun d'eux, puisqu'ils sont tous impuissants et froids. Dans cette extrémité, il tourne naturellement ses regards vers cet être immense qui seul s'élève au milieu de l'abaissement universel. C'est vers lui que ses besoins et surtout ses désirs le ramènent sans cesse, et c'est lui qu'il finit par envisager comme le soutien unique et nécessaire de la faiblesse individuelle.
Ceci achève de faire comprendre ce qui se passe souvent chez les peuples démocratiques, où l'on voit les hommes qui supportent si malaisément des supérieurs souffrir patiemment un maître, et se montrer tout à la fois fiers et serviles.
La haine que les hommes portent au privilège s'augmente à mesure que les privilèges deviennent plus rares et moins grands, de telle sorte qu'on dirait que les passions démocratiques s'enflamment davantage dans le temps même où elles trouvent le moins d'aliments. J'ai déjà donné la raison de ce phénomène. Il n'y a pas de si grande inégalité qui blesse les regards lorsque toutes les conditions sont inégales; tandis que la plus petite dissemblance paraît choquante au sein de l'uniformité générale; la vue en devient plus insupportable à mesure que l'uniformité est plus complète. Il est donc naturel que l'amour de l'égalité croisse sans cesse avec l'égalité elle-même; en le satisfaisant, on le développe.
Cette haine immortelle, et de plus en plus allumée, qui anime les peuples démocratiques contre les moindres privilèges, favorise singulièrement la concentration graduelle de tous les droits politiques dans les mains du seul représentant de l'État. Le souverain, étant nécessairement et sans contestation au-dessus de tous les citoyens, n'excite l'envie d'aucun d'eux, et chacun croit enlever à ses égaux toutes les prérogatives qu'il lui concède.
L'homme des siècles démocratiques n'obéit qu'avec une extrême répugnance a son voisin qui est son égal; il refuse de reconnaître à celui-ci des lumières supérieures aux siennes; il se défie de sa justice et voit avec jalousie son pouvoir; il le craint et le méprise; il aime à lui faire sentir à chaque instant la commune dépendance où ils sont tous les deux du même maître.
Toute puissance centrale qui suit ces instincts naturels aime l'égalité et la favorise; car l'égalité facilite singulièrement l'action d'une semblable puissance, l'étend et l'assure.
On peut dire également que tout gouvernement central adore l'uniformité; l'uniformité lui évite l'examen d'une infinité de détails dont il devrait s'occuper, s'il fallait faire la règle pour les hommes, au lieu de faire passer indistinctement tous les hommes sous la même règle, Ainsi, le gouvernement aime ce que les citoyens aiment, et il hait naturellement ce qu'ils haïssent. Cette communauté de sentiments qui, chez les nations démocratiques, unit continuellement dans une même pensée chaque individu et le souverain, établit entre eux une secrète et permanente sympathie. On pardonne au gouvernement ses fautes en faveur de ses goûts, la confiance publique ne l'abandonne qu'avec peine au milieu de ses excès ou de ses erreurs, et elle revient à lui dès qu'il la rappelle. Les peuples démocratiques haïssent souvent les dépositaires du pouvoir central; mais ils aiment toujours ce pouvoir lui-même.
(...)
De quelques causes particulières et accidentelles qui achèvent de porter un peuple démocratique à centraliser le pouvoir ou qui l'en détournent (2.4.4)
(...)
Si, dans tous les temps, les lumières servent aux hommes à défendre leur indépendance, cela est surtout vrai dans les siècles démocratiques. Il est aisé, quand tous les hommes se ressemblent, de fonder un gouvernement unique et tout-puissant; les instincts suffisent. Mais il faut aux hommes beaucoup d'intelligence, de science et d'art, pour organiser et maintenir, dans les mêmes circonstances, des pouvoirs secondaires, et pour créer, au milieu de l'indépendance et de la faiblesse individuelle des citoyens, des associations libres qui soient en état de lutter contre la tyrannie sans détruire l'ordre.
La concentration des pouvoirs et la servitude individuelle croîtront donc, chez les nations démocratiques, non seulement en proportion de l'égalité, mais en raison de l'ignorance.
Il est vrai que, dans les siècles peu éclairés, le gouvernement manque souvent de lumières pour perfectionner le despotisme, comme les citoyens pour s'y dérober. Mais l'effet n'est point égal des deux parts.
Quelque grossier que soit un peuple démocratique, le pouvoir central qui le dirige n'est jamais complètement privé de lumières, parce qu'il attire aisément à lui le peu qui s'en rencontre dans le pays, et que, au besoin, il va en chercher au-dehors. Chez une nation qui est ignorante aussi bien que démocratique, il ne peut donc manquer de se manifester bientôt une différence prodigieuse entre la capacité intellectuelle du souverain et celle de chacun de ses sujets. Cela achève de concentrer aisément dans ses mains tous les pouvoirs. La puissance administrative de l'État s'étend sans cesse, parce qu'il n'y a que lui qui soit assez habile pour administrer.
Les nations aristocratiques, quelque peu éclairées qu'on les suppose, ne donnent jamais le même spectacle, parce que les lumières y sont assez également réparties entre le prince et les principaux citoyens.
(...)
L'attraction des pouvoirs administratifs vers le centre sera toujours moins aisée et moins rapide avec des rois qui tiennent encore par quelque endroit à l'ancien ordre aristocratique, qu'avec des princes nouveaux, fils de leurs oeuvres, que leur naissance, leurs préjugés, leurs instincts, leurs habitudes, semblent lier indissolublement à la cause de l'égalité. Je ne veux point dire que les princes d'origine aristocratique qui vivent dans les siècles de démocratie ne cherchent point à centraliser. Je crois qu'ils s'y emploient aussi diligemment que tous les autres. Pour eux, les seuls avantages de l'égalité sont de ce côté; mais leurs facilités sont moindres, parce que les citoyens, au lieu d'aller naturellement au-devant de leurs désirs, ne s'y prêtent souvent qu'avec peine. Dans les sociétés démocratiques, la centralisation sera toujours d'autant plus grande que le souverain sera moins aristocratique: voilà la règle.
(...)
La première, et en quelque sorte la seule condition nécessaire pour arriver à centraliser la puissance publique dans une société démocratique, est d'aimer l'égalité ou de le faire croire. Ainsi, la science du despotisme, si compliquée jadis, se simplifie : elle se réduit, pour ainsi dire, à un principe unique.
Que parmi les nations européennes de nos jours le pouvoir souverain s'accroît, quoique les souverains soient moins stables (2.4.5)
Si l'on vient à réfléchir sur ce qui précède, on sera surpris et effrayé de voir comment, en Europe, tout semble concourir à accroître indéfiniment les prérogatives du pouvoir central et à rendre chaque jour l'existence individuelle plus faible, plus subordonnée et plus précaire.
Les nations démocratiques de l'Europe ont toutes les tendances générales et permanentes qui portent les Américains vers la centralisation des pouvoirs, et, de plus, elles sont soumises à une multitude de causes secondaires et accidentelles que les Américains ne connaissent point. On dirait que chaque pas qu'elles font vers l'égalité les rapproche du despotisme.
(...)
Ce que je veux remarquer, c’est que tous ces droits divers qui ont été arrachés successivement, de notre temps, à des classes, à des corporations, à des hommes, n'ont point servi à élever sur une base plus démocratique de nouveaux pouvoirs secondaires, mais se sont concentrés de toutes parts dans les mains du souverain. Partout l'État arrive de plus en plus à diriger par lui-même les moindres citoyens et à conduire seul chacun d'eux dans les moindres affaires.
Presque tous les établissements charitables de l'ancienne Europe étaient dans les mains de particuliers ou de corporations; ils sont tous tombés plus ou moins sous la dépendance du souverain, et, dans plusieurs pays, ils sont régis par lui. C'est l'État qui a entrepris presque seul de donner du pain à ceux qui ont faim, des secours et un asile aux malades, du travail aux oisifs, il s'est fait le réparateur presque unique de toutes les misères.
L'éducation, aussi bien que la charité, est devenue, chez la plupart des peuples de nos jours, une affaire nationale. l'État reçoit et souvent prend l'enfant des bras de sa mère pour le confier à ses agents; c'est lui qui se charge d'inspirer à chaque génération des sentiments, et de lui fournir des idées. L'uniformité règne dans les études comme dans tout le reste; la diversité comme la liberté en disparaissent chaque jour.
(...)
J'affirme qu'il n'y a pas de pays en Europe où l'administration publique ne soit devenue non seulement plus centralisée, mais plus inquisitive et plus détaillée; partout elle pénètre plus avant que jadis dans les affaires privées; elle règle à sa manière plus d'actions, et des actions plus petites, et elle s'établit davantage tous les jours, à côté, autour et au-dessus de chaque individu, pour l'assister, le conseiller et le contraindre.
(...)
Ainsi, l'État attire à lui l'argent des riches par l'emprunt, et par les caisses d'épargne il dispose à son gré des deniers du pauvre. Près de lui et dans ses mains, les richesses du pays accourent sans cesse; elles s'y accumulent d'autant plus que l'égalité des conditions devient plus grande; car, chez une nation démocratique, il n'y a que l'État qui inspire de la confiance aux particuliers, parce qu'il n'y a que lui seul qui leur paraisse avoir quelque force et quelque durée.
Ainsi le souverain ne se borne pas à diriger la fortune publique; il s'introduit encore dans les fortunes privées; il est le chef de chaque citoyen et souvent son maître, et, de plus, il se fait son intendant et son caissier.
Non seulement le pouvoir central remplit seul la sphère entière des anciens pouvoirs, l'étend et la dépasse, mais il s'y meut avec plus d'agilité, de force et d'indépendance qu'il ne faisait jadis.
(...)
Quelle espèce de despotisme les nations démocratiques ont à craindre (2.4.6)
J'avais remarqué durant mon séjour aux États-Unis qu'un état social démocratique semblable à celui des Américains pourrait offrir des facilités singulières à l'établissement du despotisme, et j'avais vu à mon retour en Europe combien la plupart de nos princes s'étaient déjà servis des idées, des sentiments et des besoins que ce même état social faisait naître, pour étendre le cercle de leur pouvoir.
Cela me conduisit à croire que les nations chrétiennes finiraient peut-être par subir quelque oppression pareille à celle qui pesa jadis sur plusieurs des peuples de l'Antiquité.
Un examen plus détaillé du sujet et cinq ans de méditations nouvelles n'ont point diminué mes craintes, mais ils en ont changé l'objet.
On n'a jamais vu dans les siècles passés de souverain si absolu et si puissant qui ait entrepris d'administrer par lui-même, et sans les secours de pouvoirs secondaires, toutes les parties d'un grand empire; il n'y en a point qui ait tenté d'assujettir indistinctement tous ses sujets aux détails d'une règle uniforme, ni qui soit descendu à côté de chacun d'eux pour le régenter et le conduire. L'idée d'une pareille entreprise ne s'était jamais présentée à l'esprit humain, et, s'il était arrivé à un homme de la concevoir, l'insuffisance des lumières, l'imperfection des procédés administratifs, et surtout les obstacles naturels que suscitait l'inégalité des conditions l'auraient bientôt arrêté dans l'exécution d'un si vaste dessein.
On voit qu'au temps de la plus grande puissance des Césars, les différents peuples qui habitaient le monde romain avaient encore conservé des coutumes et des moeurs diverses: quoique soumises au même monarque, la plupart des provinces étaient administrées à part; elles étaient remplies de municipalités puissantes et actives, et, quoique tout le gouvernement de l'empire fût concentré dans les seules mains de l'empereur, et qu'il restât toujours, au besoin, l'arbitre de toutes choses, les détails de la vie sociale et de l'existence individuelle échappaient d'ordinaire à son contrôle.
Les empereurs possédaient, il est vrai, un pouvoir immense et sans contrepoids, qui leur permettait de se livrer librement à la bizarrerie de leurs penchants et d'employer à les satisfaire la force entière de l'État; il leur est arrivé souvent d'abuser de ce pouvoir pour enlever arbitrairement à un citoyen ses biens ou sa vie: leur tyrannie pesait prodigieusement sur quelques-uns; mais elle ne s'étendait pas sur un grand nombre; elle s'attachait à quelques grands objets principaux, et négligeait le reste; elle était violente et restreinte.
Il semble que, si le despotisme venait à s'établir chez les nations démocratiques de nos jours, il aurait d'autres caractères : il serait plus étendu et plus doux, et il dégraderait les hommes sans les tourmenter.
Je ne doute pas que, dans des siècles de lumières et d'égalité comme les nôtres, les souverains ne parvinssent plus aisément à réunir tous les pouvoirs publics dans leurs seules mains, et à pénétrer plus habituellement et plus profondément dans le cercle des intérêts privés, que n'a jamais pu le faire aucun de ceux de l'Antiquité. Mais cette même égalité, qui facilite le despotisme, le tempéré; nous avons vu comment, à mesure que les hommes sont plus semblables et plus égaux, les moeurs publiques deviennent plus humaines et plus douces; quand aucun citoyen n'a un grand pouvoir ni de grandes richesses, la tyrannie manque, en quelque sorte, d'occasion et de théâtre. Toutes les fortunes étant médiocres, les passions sont naturellement contenues, l'imagination bornée, les plaisirs simples. Cette modération universelle modère le souverain lui-même et arrête dans de certaines limites l'élan désordonné de ses désirs.
Indépendamment de ces raisons puisées dans la nature même de l'état social, je pourrais en ajouter beaucoup d'autres que je prendrais en dehors de mon sujet; mais je veux me tenir dans les bornes que je me suis posées.
Les gouvernements démocratiques pourront devenir violents et même cruels dans certains moments de grande effervescence et de grands périls; mais ces crises seront rares et passagères.
Lorsque je songe aux petites passions des hommes de nos jours, à la mollesse de leurs moeurs, à l'étendue de leurs lumières, à la pureté de leur religion, à la douceur de leur morale, à leurs habitudes laborieuses et rangées, à la retenue qu'ils conservent presque tous dans le vice comme dans la vertu, je ne crains pas qu'ils rencontrent dans leurs chefs des tyrans, mais plutôt des tuteurs.
Je pense donc que l'espèce d'oppression, dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l'a précédée dans le monde; nos contemporains ne sauraient en trouver l'image dans leurs souvenirs. Je cherche en vain moi-même une expression qui reproduise exactement l'idée que je m'en forme et la renferme; les anciens mots de despotisme et de tyrannie ne conviennent point. La chose est nouvelle, il faut donc tâcher de la définir, puisque je ne peux la nommer.
Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde: je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres: ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas; il les touche et ne les sent point; il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et, s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie.
Au-dessus de ceux-là s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sut leur sort. il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril; mais il ne cherche, au contraire, qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur; mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs. principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages, que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ?
C'est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre; qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace, et dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses : elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait.
Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière; il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule ; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige; il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse; il ne détruit point, il empêche de naître; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation a n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger.
J'ai toujours cru que cette sorte de servitude, réglée, douce et paisible, dont je viens de faire le tableau, pourrait se combiner mieux qu'on ne l'imagine avec quelques-unes des formes extérieures de la liberté, et qu'il ne lui serait pas impossible de s'établir à l'ombre même de la souveraineté du peuple.
Nos contemporains sont incessamment travaillés par deux passions ennemies: ils sentent le besoin d'être conduits et l'envie de rester libres. Ne pouvant détruire ni l'un ni l'autre de ces instincts contraires, ils s'efforcent de les satisfaire à la fois tous les deux. Ils imaginent un pouvoir unique, tutélaire, tout-puissant, mais élu par les citoyens. Ils combinent la centralisation et la souveraineté du peuple. Cela leur donne quelque relâche. Ils se consolent d'être en tutelle, en songeant qu'ils ont eux-mêmes choisi leurs tuteurs. Chaque individu souffre qu'on l'attache, parce qu'il voit que ce n'est pas un homme ni une classe, mais le peuple lui-même, qui tient le bout de la chaîne.
Dans ce système, les citoyens sortent un moment de la dépendance pour indiquer leur maître, et y rentrent.
Il y a, de nos jours, beaucoup de gens qui s'accommodent très aisément de cette espèce de compromis entre le despotisme administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez garanti la liberté des individus, quand c'est au pouvoir national qu'ils la livrent. Cela ne me suffit point. La nature du maître m'importe bien moins que l'obéissance.
Je ne nierai pas cependant qu'une constitution semblable ne soit infiniment préférable à celle qui, après avoir concentré tous les pouvoirs, les déposerait dans les mains d'un homme ou d'un corps irresponsable. De toutes les différentes formes que le despotisme démocratique pourrait prendre, celle-ci serait assurément la pire.
Lorsque le souverain est électif ou surveillé de près par une législature réellement élective et indépendante, l'oppression qu'il fait subir aux individus est quelquefois plus grande; mais elle est toujours moins dégradante parce que chaque citoyen, alors qu'on le gêne et qu'on le réduit à l'impuissance, peut encore se figurer qu'en obéissant il ne se soumet qu'à lui-même, et que c’est à l'une de ses volontés qu'il sacrifie toutes les autres.
Je comprends également que, quand le souverain représente la nation et dépend d'elle, les forces et les droits qu'on enlève à chaque citoyen ne servent pas seulement au chef de l'État, mais profitent à l'État lui même, et que les particuliers retirent quelque fruit du sacrifice qu'ils ont fait au public de leur indépendance.
Créer une représentation nationale dans un pays très centralisé, c’est donc diminuer le mal que l'extrême centralisation peut produire, mais ce n'est pas le détruire.
Je vois bien que, de cette manière, on conserve l'intervention individuelle dans les plus importantes affaires; mais on ne la supprime pas moins dans les petites et les particulières. L'on oublie que c’est surtout dans le détail qu'il est dangereux d'asservir les hommes. Je serais, pour ma part, porte a croire la liberté moins nécessaire dans les grandes choses que dans les moindres, si je pensais qu'on pût jamais être assuré de l'une sans posséder l'autre.
La sujétion dans les petites affaires se manifeste tous les jours et se fait sentir indistinctement à tous les citoyens. Elle ne les désespère point; mais elle les contrarie sans cesse et elle les porte à renoncer à l'usage de leur volonté. Elle éteint ainsi peu à peu leur esprit et énerve leur âme, tandis que l'obéissance, qui n'est due que dans un petit nombre de circonstances très graves, mais très rares, ne montre la servitude que de loin en loin et ne la fait peser que sur certains hommes. En vain chargerez-vous ces mêmes citoyens, que vous avez rendus si dépendants du pouvoir central, de choisir de temps à autre les représentants de ce pouvoir; cet usage si important, mais si court et si rare, de leur libre arbitre, n'empêchera pas qu'ils ne perdent peu à peu la faculté de penser de sentir et d'agir par eux-mêmes, et qu'ils ne tombent ainsi graduellement au-dessous du niveau de l'humanité.
J'ajoute qu'ils deviendront bientôt incapables d'exercer le grand et unique privilège qui leur reste. Les peuples démocratiques qui ont introduit la liberté dans la sphère politique, en même temps qu'ils accroissaient le despotisme dans la sphère administrative, ont été conduits à des singularités bien étranges. Faut-il mener les petites affaires où le simple bon sens peut suffire, ils estiment que les citoyens en sont incapables; s'agit-il du gouvernement de tout l'État, ils confient à ces citoyens d'immenses prérogatives; ils en font alternativement les jouets du souverain et ses maîtres, plus que des rois et moins que des hommes. Après avoir épuisé tous les différents systèmes d'élection, sans en trouver un qui leur convienne, ils s'étonnent et cherchent encore; comme si le mal qu'ils remarquent ne tenait pas à la constitution du pays bien plus qu'à celle du corps électoral.
Il est, en effet, difficile de concevoir comment des hommes qui ont entièrement renoncé à l'habitude de se diriger eux-mêmes pourraient réussir à bien choisir ceux qui doivent les conduire; et l'on ne fera point croire qu'un gouvernement libéral, énergique et sage, puisse jamais sortir des suffrages d'un peuple de serviteurs.
Une constitution qui serait républicaine par la tête, et ultra-monarchique dans toutes les autres parties, m'a toujours semblé un monstre éphémère. Les vices des gouvernants et l'imbécillité des gouvernés ne tarderaient pas a cri amener la ruine; et le peuple, fatigué de ses représentants et de lui-même, créerait des institutions plus libres, ou retournerait bientôt s'étendre aux pieds d'un seul maître.
Vue générale du sujet (2.4.8)
(...)
Je promène mes regards sur cette foule innombrable composée d'êtres pareils, où rien ne s'élève ni ne s'abaisse. Le spectacle de cette uniformité universelle m'attriste et me glace, et je suis tenté de regretter la société qui n'est plus.
Lorsque le monde était rempli d'hommes très grands et très petits, très riches et très pauvres, très savants et très ignorants, je détournais mes regards des seconds pour ne les attacher que sur les premiers, et ceux-ci réjouissaient ma vue; mais je comprends que ce plaisir naissait de ma faiblesse: c'est parce que je ne puis voir en même temps tout ce qui m'environne qu'il m'est permis de choisir ainsi et de mettre à part, parmi tant d'objets, ceux qu'il me plait de contempler. Il n'en est pas de même de l'Être tout-puissant et éternel, dont l’oeil enveloppe nécessairement l'ensemble des choses, et qui voit distinctement, bien qu'à la fois, tout le genre humain et chaque homme.
Il est naturel de croire que ce qui satisfait le plus les regards de ce créateur et de ce conservateur des hommes, ce n'est point la prospérité singulière de quelques-uns, mais le plus grand bien-être de tous: ce qui me semble une décadence est donc à ses yeux un progrès; ce qui me blesse lui agrée. L'égalité est moins élevée peut-être; mais elle est plus juste, et sa justice fait sa grandeur et sa beauté.
Je m'efforce de pénétrer dans ce point de vue de Dieu, et c'est de là que je cherche à considérer et à juger les choses humaines.
Personne, sur la terre, ne peut encore affirmer d'une manière absolue et générale que l'état nouveau des sociétés soit supérieur à l'état ancien; mais il est déjà aisé de voir qu'il est autre.
(...)
Pour moi qui, parvenu à ce dernier terme de ma course, découvre de loin, mais à la fois, tous les objets divers que j'avais contemplés à part en marchant, je me sens plein de craintes et plein d'espérances. Je vois de grands périls qu'il est possible de conjurer; de grands maux qu'on peut éviter ou restreindre, et je m'affermis de plus en plus dans cette croyance que, pour erre honnêtes et prospères, il suffit encore aux nations démocratiques de le vouloir.
Je n'ignore pas que plusieurs de mes contemporains ont pensé que les peuples ne sont jamais ici-bas maîtres d'eux-mêmes, et qu'ils obéissent nécessairement à je ne sais quelle force insurmontable et inintelligente qui naît des événements antérieurs, de la race, du soi ou du climat.
Ce sont là de fausses et lâches doctrines, qui ne sauraient jamais produire que des hommes faibles et des nations pusillanimes: la Providence ris créé le genre humain ni entièrement indépendant, ni tout à fait esclave. Elle trace, il est vrai, autour de chaque homme, un cercle fatal dont il ne peut sortir; mais, dans ses vastes limites, l'homme est puissant et libre; ainsi des peuples.
Les nations de nos jours ne sauraient faire que dans leur sein les conditions ne soient pas égales; mais il dépend d'elles que l'égalité les conduise à la servitude ou à la liberté, aux lumières ou à la barbarie, à la prospérité ou aux misères.
|
http://cura.free.fr/docum/10toc-fr.html ----------------------- Tous droits réservés © 2001-2003 Patrice Guinard |
|
|
 |
|